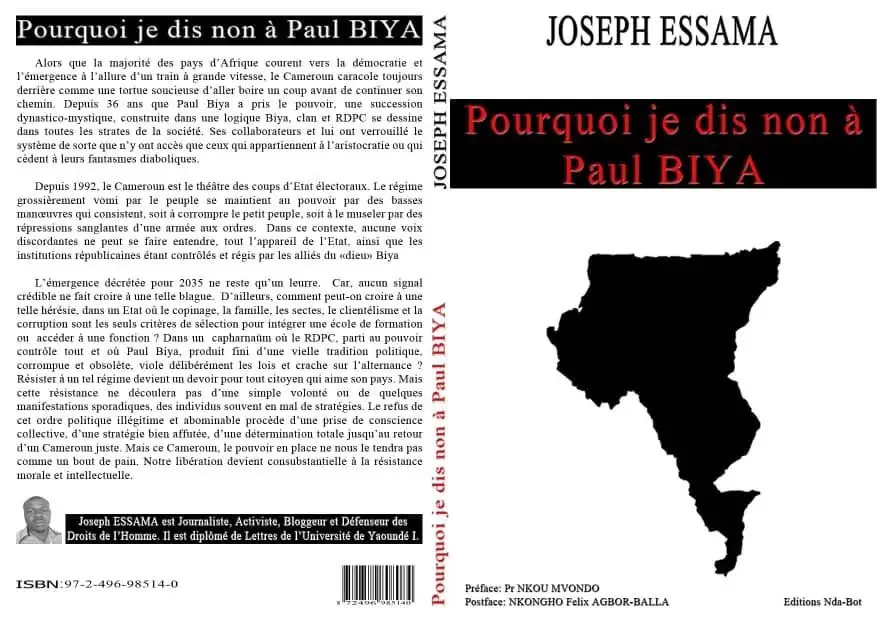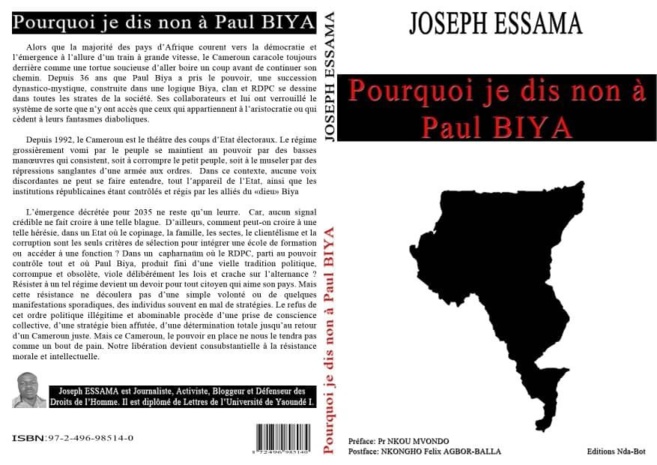« 36 ans, comme 36 kilomètres à pieds ». L’auteur de cet essai donne le ton dès les premières lignes, tout en prenant soin de se décharger de tout amalgame : ce n’est pas l’homme qui est attaqué, mais sa gestion du pouvoir et le système. Pourtant, difficile de se détacher de cette considération tant la Biyacratie, est écornée. La Biyacratie c’est quoi ? Ce modèle de pouvoir et ce système de gouvernance qui porte le nom de Paul Biya.
Officiellement, le Cameroun est un État de droit. L’auteur rappelle ce qui est « connu de tous », mais que « la pratique a totalement dévoyé » (Page 92). Cette affirmation n’est pas gratuite puisqu’elle est nourrie d’affirmations qui ne laissent au final que peu de place au doute. Pourtant, Biya, lors de son accession au pouvoir, a hérité d’un pays « économiquement en santé », faisant même penser à « un miracle camerounais ». Que s’est-il passé ? Les dignitaires ont sans doute quelque chose à dire. Eux, sont accusés de s’être « lancés dans le pillage sans merci des caisses de l’État » (page 12), hissant le pays au rang des plus corrompus au monde. Difficile de distribuer des points à ce pays qui a été « double champion du monde de la corruption » entre 1998 et 1999 (Transparency International, page 12).
Aujourd’hui, que reste-t-il du Cameroun ? Les performances économiques sont passées au crible, « inacceptables au regard du potentiel dont dispose le pays ». L’épineuse question du pétrole est abordée : une production continue mais un état de développement faible. La seule certitude de l’auteur : « l’argent issu de la vente du pétrole ne profite pas aux Camerounais » (page 40), au point d’y voir une éventuelle complicité criminelle des gouvernants « avec les puissances étrangères dans le but de spolier le petit peuple ». Qui peut voir sans frémir ce crime organisé ? « Aucun homme ». L’auteur défend la peine capitale pour les personnes reconnues coupable de corruption, mais uniquement au terme d’un procès équitable (page 65).
La presse privée qui “refuse de faire bon ménage avec le régime” a droit à la censure ou à des interdictions de publication pendant des longs mois (page 73). Des scandales à répétition ont entaché l’image du Cameroun (ENSP, ENAM, IRIC). Les critères d’admission dans ces grandes écoles ces 10 dernières années « ont plus que jamais obéi à la lugubre loi de l’équilibre familial » (page 82). L’ascension sociale se fait par reproduction clientéliste : “C’est au sein de l’administration centrale qu’il faut même fouiner les tentacules de cette poudrière tribale, masquée sous le couvert de l’équilibre régional” (page 89). Nous assistons ainsi à la création de deux catégories de citoyens : “Celle des éternels bienfaiteurs et celle des éternels assistés” (Page 90). La justice n’est pas ce qu’elle devrait être : De Titus Edzoa à Marafa Hamidou Yaya, en passant par Paul Éric Kingue, leurs procès ont marqué le sceau de l’infamie (page 94).
L’amitié avec la France est dépeinte : des firmes, un monopole économique et une exploitation des ressources naturelles sachant que sur les 59 plateformes pétrolières que le Cameroun détenait en 2011, 47 appartenaient aux groupes français Total et Perenco qui géraient respectivement 41 et 6 puits (page 113). Tout cela a un prix : la protection du « régime de Yaoundé » (page 111).
Le regard croisé de différentes personnalités politiques ne fait qu’édifier le constant que dresse les 150 pages de l’essai. Au final, le président de la République a déçu et n’a pas répondu aux attentes des camerounais. Pourtant, l’auteur s’efforce de ne pas en vouloir à Biya, au point de lui vouer du respect en tant qu’aîné, compatriote et humain. Toutefois, il est difficile de garder le silence lorsque « rien n’a bougé en 36 ans » (page 20), et que des citoyens n’ont « jamais gouté la saveur inhérente à la dignité humaine » (page 146).
Face à ce désastre, l’auteur demande à chaque camerounais de s’interroger sur son apport concret pour le changement du Cameroun car « à l’ère de la démocratie et des droits humains, une telle société doit disparaitre. » Tous les camerounais ont une responsabilité dans cette « putréfaction de la société » (page 16). L’apport de chacun pour bâtir ce pays est une obligation (page 17), et cela passe par un éveil de conscience, car fuir ses responsabilités, c’est prendre le risque d’être rattrapé par l’histoire (Page 18).
Cet exécutoire, entendez-le comme un cri de détresse, voire même « une révolte ». Il reflète en miniature les maux relativement communs de plusieurs autre pays africains. Est-ce finalement un syndrome ? L’auteur décrit une réalité à l’attention des gouvernants qui s’offusquent à la moindre critique : comment les soutenir eux ou leur parti lorsqu’il existe des bidons-villes dans la capitale, nids de poules dans les routes, que des nouveaux nés meurent dans des hôpitaux faute de couveuse, quand la pénurie d’eau potable frappe de plein fouet. Face à cela, l’auteur légitimiste le combat, l’affront pour espérer la libération. Il cite Spinoza avec son traité theologico-politique, et sa définition sur la paix et l’absence de guerre.
La notion du paix, l’auteur s’en appesantit longuement dessus, citant au passage le philosophe tchadien Beral Mbaikoubou : « La paix est la somme des tranquillités socio-économiques, politiques, culturelles dont peuvent jouir les membres d’une société, pense » (page 33). Mais comment préserver cette paix lorsque des « charlatans et ayatollah acquis au régime » adoptent une démarche qui « n’inspire que la révolte » ? Pendant ce temps, c’est le pays qui « s’enfonce irréversiblement » (page 44).
Le déni systématique pousse à nier le problème de la région anglophone (page 57). « On ne peut pas continuer à cohabiter pacifiquement tant que nous continuerons à considérer près de 20% de notre population comme des citoyens subalternes », défend l’auteur (page 58). De même, le Cameroun ne peut pas se développer en ignorant ou en brutalisant 80% de sa population (page 152). Les camerounais doivent se réunir et discuter de solutions (page 59). Parmi elles, l’option du fédéralisme est défendue et se précise : un fédéralisme à 4, répartis comme suit, Centre-Sud-Est ; Littoral-Sud-ouest ; Grand nord ; Ouest-Nord-ouest (page 62). Une certitude de l’auteur : le fédéralisme viendra développer immédiatement le Cameroun.
Les camerounais ont la responsabilité de créer leurs propres « modèles de développement économiques, sociaux et spirituel ». De même, l’école doit devenir « un lieu par excellence de façonnement des citoyens. »
Pour se débarrasser des chaines, l’auteur préconise de « bousculer ce qui est immobile et, de déstabiliser ce qui est immuable », grâce à « des camerounais révolutionnaires, capables d’ébranler, par leur détermination l’ordre établi ». Il prend exemple sur la société civile au Sénégal ou au Burkina Faso (page 150).
Au delà de tous ces maux, il y a le rêve partagé d'un Cameroun où « tous les citoyens seront des guides, des forces de propositions, des forces de décisions, des forces d’actions, des forces vives » (page 152). Ainsi, malgré des piliers fragiles de la démocratie, il revient aux citoyens « de jouer le rôle de catalyseur et d’acteur, dans le processus d’enfantement de nouveaux citoyens ». Et ce, l’auteur le rappelle si bien : « nous devons être ces citoyens qui acceptent de payer leurs taxes, plutôt que de donner 500 Fcfa à un policier ».
Note de lecture, par Djamil Ahmat
Officiellement, le Cameroun est un État de droit. L’auteur rappelle ce qui est « connu de tous », mais que « la pratique a totalement dévoyé » (Page 92). Cette affirmation n’est pas gratuite puisqu’elle est nourrie d’affirmations qui ne laissent au final que peu de place au doute. Pourtant, Biya, lors de son accession au pouvoir, a hérité d’un pays « économiquement en santé », faisant même penser à « un miracle camerounais ». Que s’est-il passé ? Les dignitaires ont sans doute quelque chose à dire. Eux, sont accusés de s’être « lancés dans le pillage sans merci des caisses de l’État » (page 12), hissant le pays au rang des plus corrompus au monde. Difficile de distribuer des points à ce pays qui a été « double champion du monde de la corruption » entre 1998 et 1999 (Transparency International, page 12).
Aujourd’hui, que reste-t-il du Cameroun ? Les performances économiques sont passées au crible, « inacceptables au regard du potentiel dont dispose le pays ». L’épineuse question du pétrole est abordée : une production continue mais un état de développement faible. La seule certitude de l’auteur : « l’argent issu de la vente du pétrole ne profite pas aux Camerounais » (page 40), au point d’y voir une éventuelle complicité criminelle des gouvernants « avec les puissances étrangères dans le but de spolier le petit peuple ». Qui peut voir sans frémir ce crime organisé ? « Aucun homme ». L’auteur défend la peine capitale pour les personnes reconnues coupable de corruption, mais uniquement au terme d’un procès équitable (page 65).
La presse privée qui “refuse de faire bon ménage avec le régime” a droit à la censure ou à des interdictions de publication pendant des longs mois (page 73). Des scandales à répétition ont entaché l’image du Cameroun (ENSP, ENAM, IRIC). Les critères d’admission dans ces grandes écoles ces 10 dernières années « ont plus que jamais obéi à la lugubre loi de l’équilibre familial » (page 82). L’ascension sociale se fait par reproduction clientéliste : “C’est au sein de l’administration centrale qu’il faut même fouiner les tentacules de cette poudrière tribale, masquée sous le couvert de l’équilibre régional” (page 89). Nous assistons ainsi à la création de deux catégories de citoyens : “Celle des éternels bienfaiteurs et celle des éternels assistés” (Page 90). La justice n’est pas ce qu’elle devrait être : De Titus Edzoa à Marafa Hamidou Yaya, en passant par Paul Éric Kingue, leurs procès ont marqué le sceau de l’infamie (page 94).
L’amitié avec la France est dépeinte : des firmes, un monopole économique et une exploitation des ressources naturelles sachant que sur les 59 plateformes pétrolières que le Cameroun détenait en 2011, 47 appartenaient aux groupes français Total et Perenco qui géraient respectivement 41 et 6 puits (page 113). Tout cela a un prix : la protection du « régime de Yaoundé » (page 111).
Le regard croisé de différentes personnalités politiques ne fait qu’édifier le constant que dresse les 150 pages de l’essai. Au final, le président de la République a déçu et n’a pas répondu aux attentes des camerounais. Pourtant, l’auteur s’efforce de ne pas en vouloir à Biya, au point de lui vouer du respect en tant qu’aîné, compatriote et humain. Toutefois, il est difficile de garder le silence lorsque « rien n’a bougé en 36 ans » (page 20), et que des citoyens n’ont « jamais gouté la saveur inhérente à la dignité humaine » (page 146).
Face à ce désastre, l’auteur demande à chaque camerounais de s’interroger sur son apport concret pour le changement du Cameroun car « à l’ère de la démocratie et des droits humains, une telle société doit disparaitre. » Tous les camerounais ont une responsabilité dans cette « putréfaction de la société » (page 16). L’apport de chacun pour bâtir ce pays est une obligation (page 17), et cela passe par un éveil de conscience, car fuir ses responsabilités, c’est prendre le risque d’être rattrapé par l’histoire (Page 18).
Cet exécutoire, entendez-le comme un cri de détresse, voire même « une révolte ». Il reflète en miniature les maux relativement communs de plusieurs autre pays africains. Est-ce finalement un syndrome ? L’auteur décrit une réalité à l’attention des gouvernants qui s’offusquent à la moindre critique : comment les soutenir eux ou leur parti lorsqu’il existe des bidons-villes dans la capitale, nids de poules dans les routes, que des nouveaux nés meurent dans des hôpitaux faute de couveuse, quand la pénurie d’eau potable frappe de plein fouet. Face à cela, l’auteur légitimiste le combat, l’affront pour espérer la libération. Il cite Spinoza avec son traité theologico-politique, et sa définition sur la paix et l’absence de guerre.
La notion du paix, l’auteur s’en appesantit longuement dessus, citant au passage le philosophe tchadien Beral Mbaikoubou : « La paix est la somme des tranquillités socio-économiques, politiques, culturelles dont peuvent jouir les membres d’une société, pense » (page 33). Mais comment préserver cette paix lorsque des « charlatans et ayatollah acquis au régime » adoptent une démarche qui « n’inspire que la révolte » ? Pendant ce temps, c’est le pays qui « s’enfonce irréversiblement » (page 44).
« Nous devons être ces citoyens qui acceptent de payer leurs taxes, plutôt que de donner 500 Fcfa à un policier ».
Le déni systématique pousse à nier le problème de la région anglophone (page 57). « On ne peut pas continuer à cohabiter pacifiquement tant que nous continuerons à considérer près de 20% de notre population comme des citoyens subalternes », défend l’auteur (page 58). De même, le Cameroun ne peut pas se développer en ignorant ou en brutalisant 80% de sa population (page 152). Les camerounais doivent se réunir et discuter de solutions (page 59). Parmi elles, l’option du fédéralisme est défendue et se précise : un fédéralisme à 4, répartis comme suit, Centre-Sud-Est ; Littoral-Sud-ouest ; Grand nord ; Ouest-Nord-ouest (page 62). Une certitude de l’auteur : le fédéralisme viendra développer immédiatement le Cameroun.
Les camerounais ont la responsabilité de créer leurs propres « modèles de développement économiques, sociaux et spirituel ». De même, l’école doit devenir « un lieu par excellence de façonnement des citoyens. »
Pour se débarrasser des chaines, l’auteur préconise de « bousculer ce qui est immobile et, de déstabiliser ce qui est immuable », grâce à « des camerounais révolutionnaires, capables d’ébranler, par leur détermination l’ordre établi ». Il prend exemple sur la société civile au Sénégal ou au Burkina Faso (page 150).
Au delà de tous ces maux, il y a le rêve partagé d'un Cameroun où « tous les citoyens seront des guides, des forces de propositions, des forces de décisions, des forces d’actions, des forces vives » (page 152). Ainsi, malgré des piliers fragiles de la démocratie, il revient aux citoyens « de jouer le rôle de catalyseur et d’acteur, dans le processus d’enfantement de nouveaux citoyens ». Et ce, l’auteur le rappelle si bien : « nous devons être ces citoyens qui acceptent de payer leurs taxes, plutôt que de donner 500 Fcfa à un policier ».
Note de lecture, par Djamil Ahmat