
Il a eu ses détracteurs au cours des huit dernières années, mais on ne saurait reprocher à Akinwumi Adesina de manquer de passion et de résilience. Les journaux l’ont qualifié d’optimiste en chef de l’Afrique, le Nigérian aurait certainement été un piètre président de la Banque africaine de développement (www.AfDB.org) s’il avait été pessimiste.
Cette année est celle des adieux pour M. Adesina, et il fera le tour du monde pour s’entretenir avec des investisseurs et des dirigeants du monde entier, dans son style pragmatique mâtiné d’un optimisme à toute épreuve.
Dans la semaine qui a suivi ce voyage éclair à Londres, il était au sommet des dirigeants du G7, où il a serré la main de dirigeants mondiaux tels que le président américain Joe Biden, le Premier ministre indien Narendra Modi et le Pape.
Je l’interviewe depuis plus d’une décennie, depuis qu’il a servi en tant que ministre de l’Agriculture au Nigéria, et il n’a rien perdu de son énergie irrépressible.
« Ce n’est pas un travail, c’est une mission. J’ai obtenu la confiance, les ressources et la plateforme pour développer mon continent natal et je m’acquitterai de cette mission jusqu’à la dernière minute de mon mandat. Il faudra sans doute qu’on me rappelle qu’un nouveau président a été élu avant que je ne m’arrête de travailler ! »
Devant plus d’une centaine d’invités réunis à l’institut de réflexion (think tank) Chatham House, à St James’s Square, au cœur de Londres, M. Adesina prend la parole pour tout donner au nom d’un continent riche en minerais, mais toujours pauvre.
Les chiffres, les statistiques et les anecdotes s’enchaînent à un rythme effréné. M. Adesina est un conteur flamboyant, qui parle avec un sentiment d’urgence et fait des gestes avec ses mains pour souligner l’importance de son propos.
Ses manières sont le fruit d’une existence remarquable : né au Nigéria dans un milieu modeste, formé dans une grande université américaine et aguerri par de nombreuses missions dans les allées du pouvoir.
Cette approche positive et dynamique de la vie, typique de l’Ivy League, s’est manifestée très récemment, selon l’un de ses assistants.
M. Adesina devait faire un voyage en bateau dans le cadre de son travail : un chargé de la sécurité lui a demandé s’il savait nager.
La réponse fut « non ».
Mais M. Adesina ne se l’est pas fait dire deux fois : il a enfilé un maillot de bain et appris le crawl et la brasse, à l’âge de 64 ans, avant d’effectuer son voyage (sans incident).
Les défis de l’Afrique se multiplient
Pour les besoins de l’interview, nous nous rendons à l’hôtel Savoy, vieux de 135 ans, situé dans le quartier du Strand. C’est le premier hôtel de Grande-Bretagne à avoir adopté les ampoules électriques ; M. Adesina est très conscient du fait que, plus d’un siècle plus tard, des millions d’Africains n’ont toujours pas appuyé sur leur premier interrupteur.
Sa suite donne sur le pont de Waterloo, qui enjambe la Tamise grise. À trois kilomètres en aval se trouve London Bridge, où chaque matin des centaines de financiers, qui gèrent des capitaux que M. Adesina voudrait canaliser vers l’Afrique, traversent le fleuve pour se rendre à leurs bureaux dans la City de Londres.
Pour M. Adesina, toujours à la recherche de nouvelles sources de capitaux pour le continent, les défis auxquels l’Afrique est confrontée sont plus urgents que jamais.
Lorsque j’ai assisté au premier discours de M. Adesina en tant que président de la Banque africaine de développement à Johannesburg, il m’a dit qu’il voulait « une nouvelle Afrique dans laquelle les gens veulent venir, et non pas qu’ils veulent quitter ».
Huit ans plus tard, la migration à grande échelle des Africains vers l’Europe et ailleurs se poursuit et reste un enjeu politique et économique majeur des deux côtés de la Méditerranée.
Le nombre de franchissements irréguliers aux frontières extérieures de l’Union européenne a atteint un total d’environ 380 000 en 2023, sous l’effet d’une hausse des arrivées via la région méditerranéenne, selon les calculs préliminaires de Frontex [l’agence européenne de gestion des frontières]. Il s’agit du niveau le plus élevé depuis 2016 et d’une augmentation de 17 % par rapport aux chiffres de 2022, ce qui indique une tendance à la hausse constante au cours des trois dernières années.
Alors que l’exode se poursuit, la vision d’Adesina est-elle toujours d’actualité ?
« Tout d’abord, je ne suis pas opposé à l’immigration légale. Celle-ci doit se poursuivre, car c’est un marché du travail où les gens peuvent faire valoir leurs compétences, et c’est très bien ainsi », déclare-t-il.
« C’est la migration illégale forcée qui, selon moi, constitue un grand défi. Les gens oublient que 85 % de la migration des jeunes en Afrique est interne et que les gens se déplacent d’un pays à l’autre. Mais les médias ont tendance à exagérer l’importance de ce phénomène lorsque des personnes sombrent dans la Méditerranée. Mais le cœur de l’Afrique ne se vide pas dans la Méditerranée, voilà ce que je dis ».
Il reconnaît qu’un ensemble complexe de facteurs continue de pousser les Africains à émigrer, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du continent.
« Nous devons également comprendre qu’un certain nombre de facteurs ont favorisé ces migrations. Les changements climatiques ont rendu les choses beaucoup plus difficiles aussi. De nombreux conflits internes sont dus à la pauvreté, à l’inégalité ou à la pression exercée sur les ressources et aux conflits à motivation politique que nous avons connus. »
Mais demeurer chez soi comporte aussi des périls. M. Adesina prévient que si un grand nombre d’Africains sont au chômage dans des pays improductifs, les terroristes n’auront aucun mal à les recruter, comme cela s’est produit au Mozambique.
Face aux nombreux défis auxquels le continent est confronté, ne désespère-t-il pas parfois ?
« Je ne désespère pas. Je me concentre sur les défis que nous devons relever. Prenons par exemple le processus de croissance dont nous parlons beaucoup. Oui, je suis satisfait du chiffre de croissance que nous avons : ce n’est pas le niveau que nous souhaitions, mais nous avons toujours dix des vingt économies à la croissance la plus rapide au monde. »
La route est longue jusqu’au sommet
La familiarité de M. Adesina avec les choix impossibles auxquels sont confrontés les pauvres est inscrite dans son ADN.
Il est le fils d’un ancien ouvrier agricole d’Ibadan, à 128 kilomètres au nord-est de Lagos, pour qui le travail de la terre est inscrit dans les gènes. Sa vie est une remarquable histoire africaine d’ambition, d’inspiration, de détermination et d’application. M. Adesina a grandi en dormant sur une natte, aux côtés de ses frères, sans eau courante ni toilettes modernes.
« J’ai grandi dans la pauvreté. Mon grand-père et mon père travaillaient dans les fermes d’autres personnes pour un penny par jour », m’a raconté M. Adesina à Johannesburg, en 2019.
Un maître mot a guidé la vie de M. Adesina père : l’éducation. Chaque soir, il sortait un tableau noir de la petite maison familiale et enseignait l’anglais et l’arithmétique à ses jeunes fils.
« Un jour, il nous a dit que la différence entre sa vie et celle du secrétaire permanent au travail était comparable à la différence entre la lumière et l’obscurité. Mais il nous a dit que si nous travaillions pour acquérir une éducation, nous et les enfants du secrétaire permanent serions au même niveau », raconte M. Adesina.
Son père a économisé presque chaque centime gagné pour scolariser ses fils. Pourtant, il ne les a pas envoyés dans une école privée. Au lieu de cela, ils sont allés dans une école de village qui comptait 60 élèves par classe.
« Il voulait que nous comprenions la pauvreté rurale. Cela m’a permis de me faire une idée de ce que je voulais faire de ma vie. Cela m’a appris que la pauvreté est une réalité, dont je suis moi-même sorti », explique M. Adesina.
L’école du village a également enseigné au jeune Adesina le pouvoir de l’agriculture sur la vie des pauvres. Il a constaté que lorsque les récoltes étaient bonnes, il y avait toujours de l’argent pour permettre aux enfants d’aller à l’école ; si les récoltes étaient mauvaises, les enfants étaient retirés de l’école pour travailler.
Il a réussi brillamment à l’école et passé suffisamment d’examens pour entrer à l’université à l’âge de 14 ans — un succès qui a provoqué quelques tensions avec son père, qui rêvait d’une carrière médicale pour Akinwumi.
« Mon père a piqué une crise parce qu’il pensait que l’agriculture était l’endroit d’où il venait. Il n’était pas content. Finalement, mon père m’a dit : « Akin, Dieu doit vraiment vouloir que tu travailles dans l’agriculture », se souvient M. Adesina.
Il a obtenu une licence en économie agricole à l’université d’Ife, au Nigéria, en 1981. Il a ensuite obtenu un doctorat dans le même domaine, en 1988, à l’université de Purdue, dans l’Indiana, l’une des meilleures écoles d’agriculture des États-Unis.
Il a mis à profit son expertise agricole dans ses fonctions d’économiste principal à l’Association pour le développement de la riziculture en Afrique de l’Ouest, de scientifique principal à la Fondation Rockefeller et, surtout, de ministre de l’Agriculture du Nigéria de 2010 à 2015. C’est sa réussite dans ce rôle — et les contacts qu’il a noués — qui lui ont permis de se lancer dans la course à la présidence de la Banque africaine de développement.
Une machine à prêter
Quelle a donc été l’importance de ses deux mandats à la tête de la première institution multilatérale d’Afrique, et dans quelle mesure a-t-il progressé dans la résolution des défis les plus pressants du continent ?
Tout d’abord, indique M. Adesina, au cours de ses huit années à la tête de l’institution, il a permis d’accroître le pool de capitaux dont dispose la Banque africaine de développement pour investir sur le continent.
Quand il a pris ses fonctions, il a d’abord augmenté le capital à 201 milliards de dollars en 2019 : il s’élève aujourd’hui à 318 milliards de dollars, précise-t-il.
Il évoque des projets pour lesquels une partie de ces milliards a déjà été déployée. Ainsi, 50 milliards de dollars ont été investis dans les infrastructures au cours des huit dernières années, et des milliards supplémentaires ont été consacrés à l’agriculture.
Il énumère ce qu’il considère comme les principales réalisations de la Banque. « L’Éthiopie est autosuffisante en blé en moins de quatre ans. Nous mettons en place des zones de transformation agro-industrielle et des infrastructures qui permettront l’émergence de chaînes de valeur, pour un montant de 1,7 milliard de dollars », explique-t-il.
» Le Bénin avait l’habitude d’exporter de la fibre de coton. Depuis que nous avons créé des zones de transformation agro-industrielle il y a deux ans, 100 % de leurs fibres sont transformées en textiles d’habillement. Tout leur argent allait au Viêt Nam ! »
Il s’est récemment entretenu avec un groupe d’investisseurs qui souhaitaient exporter de la bauxite depuis l’Afrique.
« Je leur ai dit : Pourquoi ne pas vous lancer dans l’aluminium au lieu de vous limiter à la bauxite ? Sinon, les bénéfices seront réalisés dans un autre pays et vous finirez pauvres ».
Pourtant, M. Adesina admet que les investissements en capital n’atteignent pas les populations défavorisées qui vivent dans les zones rurales. Macrotrends estime que plus de 698 millions de personnes dans la seule Afrique subsaharienne vivent dans des zones rurales, soit environ 57 % de la population — plus de trois fois la population du Nigéria.
« Une grande partie des capitaux investis en Afrique dans les infrastructures vont dans les zones urbaines, alors que la majeure partie de la population vit dans les zones rurales. Si l’on veut vraiment sortir un grand nombre de personnes (de la pauvreté), il faut transformer ces économies rurales, car, à vrai dire, elles ne sont rien d’autre que des zones de misère économique.
La prime de risque injuste de l’Afrique
Même si son mandat touche à sa fin, M. Adesina continue de veiller à ce que les préoccupations de l’Afrique figurent en bonne place dans l’agenda mondial.
Ces derniers mois, il a répété à maintes reprises que le coût du capital était trop élevé en Afrique — en raison d’une « prime de risque » obsolète appliquée au continent par les investisseurs extérieurs et les agences de notation de crédit. L’Afrique est en particulier limitée par une pénurie de capitaux à long terme, moins chers, dits « concessionnels », affirme-t-il.
« Le financement concessionnel a chuté en Afrique. En 2010, l’exposition à la dette des pays africains était d’environ 52 % de financement concessionnel ; aujourd’hui, elle n’est plus que de 25 %. En raison de cette baisse, de nombreux pays se tournent vers les marchés des capitaux, des prêteurs privés et des prêteurs commerciaux… Lorsque vous avez beaucoup de créanciers commerciaux, c’est différent, vous devez agir de manière plus intelligente », explique-t-il.
« Ce que je demande, c’est de la transparence, c’est de la responsabilité… nous voulons que les économies se développent de manière durable sans accumuler des dettes insensées », déclare M. Adesina.
Ce qui désole M. Adesina, c’est que lorsque les pays africains se tournent vers les prêteurs commerciaux, ils risquent de payer le prix fort. Les paiements au titre du service de la dette de l’Afrique s’élèveront à 74 milliards de dollars cette année, contre 17 milliards de dollars en 2010, selon la Banque africaine de développement.
« Le coût de la mobilisation des capitaux en Afrique est trois ou quatre fois plus élevé que dans d’autres régions. Pourquoi ? En raison de la soi-disant « prime de l’Afrique ». Un pays d’Amérique latine — un pays BB en termes de notation de crédit — lève des fonds en même temps qu’un pays d’Afrique. Ce dernier paie 1,1 point de pourcentage de plus en intérêts… C’est une question de perception, et la perception n’est pas la réalité — ce sont les données qui comptent », explique-t-il.
» Quelque chose se passe dans une partie de l’Afrique et on dit que toute l’Afrique est un problème. Un coup d’État s’est produit au Niger et le président kenyan [William] Ruto m’a dit qu’il avait dû payer 220 points de base de plus pour son émission obligataire à cause du Niger, alors que le Niger est éloigné du Kenya !
M. Adesina souhaite que l’un des héritages de son mandat soit la création d’une agence de notation africaine, dirigée depuis le continent et non plus depuis Washington ou Londres. Les pays actionnaires de la Banque africaine de développement ont mandaté la banque pour examiner les moyens d’y parvenir.
« Il ne s’agit pas de rivaliser avec les agences de notation… mais de pouvoir évaluer correctement les risques, de pouvoir comparer les méthodologies et de pouvoir donner une évaluation juste. Certains pensent qu’il s’agit d’une question politique. Ce n’est absolument pas le cas. C’est absurde », déclare-t-il.
« Il s’agit simplement de s’assurer que les risques de l’Afrique sont bien compris et mieux évalués.
Les technocrates de M. Adesina auront fort à faire pour proposer un plan réalisable pour y parvenir dans sa dernière année. S’il y parvient, cela pourrait être l’un des principaux jalons de son mandat à la tête de la Banque africaine de développement.
Parallèlement, M. Adesina souhaite également lever des fonds sur les marchés de capitaux africains.
« Ce ne sont pas seulement les financements libellés en devises étrangères qui importent ; nous devons également recourir aux marchés de capitaux nationaux et utiliser beaucoup plus de financements en monnaie locale, ce que nous faisons. Nous émettons des obligations en monnaie locale, en shillings tanzaniens, en shillings ougandais, en nairas nigérians, en cédis ghanéens, etc.
M. Adesina estime que les gouvernements ont encore un rôle essentiel à jouer pour soutenir le travail de la Banque.
» Le fait de formuler la question en disant que le gouvernement devrait se retirer et laisser le secteur privé agir n’est pas judicieux. Le gouvernement ne peut pas abdiquer sa responsabilité. Dans tous les pays développés, qu’il s’agisse d’énergie, d’aviation, de médicaments, d’infrastructures ou de sécurité, le gouvernement joue un rôle prépondérant », réplique-t-il.
« Le gouvernement doit mettre en place les bonnes politiques, le bon environnement d’investissement, et il doit également injecter de l’argent pour créer des biens publics. Le secteur privé ne va pas créer de biens publics, ne nous y trompons pas. »
La fin d’une ère
Alors que le mandat de M. Adesina en tant que président de la Banque africaine de développement touche à sa fin, la course à sa succession a déjà commencé. Les observateurs estiment que le nouveau président doit être fort, décisif et visionnaire.
La personne qui remportera l’élection de l’année prochaine devra faire face à une énorme pile de dossiers. Alors que de nombreux pays africains sont toujours aux prises avec une dette croissante, une dépréciation de leur monnaie, une inflation élevée et une croissance mondiale atone, la contribution de la Banque africaine de développement au développement économique durable est d’autant plus importante.
Le président actuel a exercé un lobbying intense pour que les droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international (FMI) soient canalisés vers la Banque africaine de développement afin d’accroître la puissance de feu du continent et d’accélérer le développement.
Il incombera au nouveau président en exercice de poursuivre dans cette lancée, de faire valoir l’argument du financement concessionnel et d’acheminer les fonds là où ils sont le plus nécessaires. M. Adesina a posé les jalons, mais il est temps que d’autres prennent le relais.
Alors qu’il est à la recherche de son prochain défi, je demande à M. Adesina s’il a des regrets.
« Non. Je dis toujours que lorsque Dieu a créé les gens, il leur a donné deux yeux devant parce qu’il souhaitait qu’ils regardent vers l’avant. S’il avait voulu qu’ils regardent en arrière, il aurait mis deux yeux derrière la tête. »
Chris Bishop
Chris Bishop est rédacteur en chef et fondateur de Billionaire Tomorrow, rédacteur en chef et fondateur de Forbes Africa et ancien chef de la programmation de CNBC Africa.
Cette année est celle des adieux pour M. Adesina, et il fera le tour du monde pour s’entretenir avec des investisseurs et des dirigeants du monde entier, dans son style pragmatique mâtiné d’un optimisme à toute épreuve.
Dans la semaine qui a suivi ce voyage éclair à Londres, il était au sommet des dirigeants du G7, où il a serré la main de dirigeants mondiaux tels que le président américain Joe Biden, le Premier ministre indien Narendra Modi et le Pape.
Je l’interviewe depuis plus d’une décennie, depuis qu’il a servi en tant que ministre de l’Agriculture au Nigéria, et il n’a rien perdu de son énergie irrépressible.
« Ce n’est pas un travail, c’est une mission. J’ai obtenu la confiance, les ressources et la plateforme pour développer mon continent natal et je m’acquitterai de cette mission jusqu’à la dernière minute de mon mandat. Il faudra sans doute qu’on me rappelle qu’un nouveau président a été élu avant que je ne m’arrête de travailler ! »
Devant plus d’une centaine d’invités réunis à l’institut de réflexion (think tank) Chatham House, à St James’s Square, au cœur de Londres, M. Adesina prend la parole pour tout donner au nom d’un continent riche en minerais, mais toujours pauvre.
Les chiffres, les statistiques et les anecdotes s’enchaînent à un rythme effréné. M. Adesina est un conteur flamboyant, qui parle avec un sentiment d’urgence et fait des gestes avec ses mains pour souligner l’importance de son propos.
Ses manières sont le fruit d’une existence remarquable : né au Nigéria dans un milieu modeste, formé dans une grande université américaine et aguerri par de nombreuses missions dans les allées du pouvoir.
Cette approche positive et dynamique de la vie, typique de l’Ivy League, s’est manifestée très récemment, selon l’un de ses assistants.
M. Adesina devait faire un voyage en bateau dans le cadre de son travail : un chargé de la sécurité lui a demandé s’il savait nager.
La réponse fut « non ».
Mais M. Adesina ne se l’est pas fait dire deux fois : il a enfilé un maillot de bain et appris le crawl et la brasse, à l’âge de 64 ans, avant d’effectuer son voyage (sans incident).
Les défis de l’Afrique se multiplient
Pour les besoins de l’interview, nous nous rendons à l’hôtel Savoy, vieux de 135 ans, situé dans le quartier du Strand. C’est le premier hôtel de Grande-Bretagne à avoir adopté les ampoules électriques ; M. Adesina est très conscient du fait que, plus d’un siècle plus tard, des millions d’Africains n’ont toujours pas appuyé sur leur premier interrupteur.
Sa suite donne sur le pont de Waterloo, qui enjambe la Tamise grise. À trois kilomètres en aval se trouve London Bridge, où chaque matin des centaines de financiers, qui gèrent des capitaux que M. Adesina voudrait canaliser vers l’Afrique, traversent le fleuve pour se rendre à leurs bureaux dans la City de Londres.
Pour M. Adesina, toujours à la recherche de nouvelles sources de capitaux pour le continent, les défis auxquels l’Afrique est confrontée sont plus urgents que jamais.
Lorsque j’ai assisté au premier discours de M. Adesina en tant que président de la Banque africaine de développement à Johannesburg, il m’a dit qu’il voulait « une nouvelle Afrique dans laquelle les gens veulent venir, et non pas qu’ils veulent quitter ».
Huit ans plus tard, la migration à grande échelle des Africains vers l’Europe et ailleurs se poursuit et reste un enjeu politique et économique majeur des deux côtés de la Méditerranée.
Le nombre de franchissements irréguliers aux frontières extérieures de l’Union européenne a atteint un total d’environ 380 000 en 2023, sous l’effet d’une hausse des arrivées via la région méditerranéenne, selon les calculs préliminaires de Frontex [l’agence européenne de gestion des frontières]. Il s’agit du niveau le plus élevé depuis 2016 et d’une augmentation de 17 % par rapport aux chiffres de 2022, ce qui indique une tendance à la hausse constante au cours des trois dernières années.
Alors que l’exode se poursuit, la vision d’Adesina est-elle toujours d’actualité ?
« Tout d’abord, je ne suis pas opposé à l’immigration légale. Celle-ci doit se poursuivre, car c’est un marché du travail où les gens peuvent faire valoir leurs compétences, et c’est très bien ainsi », déclare-t-il.
« C’est la migration illégale forcée qui, selon moi, constitue un grand défi. Les gens oublient que 85 % de la migration des jeunes en Afrique est interne et que les gens se déplacent d’un pays à l’autre. Mais les médias ont tendance à exagérer l’importance de ce phénomène lorsque des personnes sombrent dans la Méditerranée. Mais le cœur de l’Afrique ne se vide pas dans la Méditerranée, voilà ce que je dis ».
Il reconnaît qu’un ensemble complexe de facteurs continue de pousser les Africains à émigrer, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du continent.
« Nous devons également comprendre qu’un certain nombre de facteurs ont favorisé ces migrations. Les changements climatiques ont rendu les choses beaucoup plus difficiles aussi. De nombreux conflits internes sont dus à la pauvreté, à l’inégalité ou à la pression exercée sur les ressources et aux conflits à motivation politique que nous avons connus. »
Mais demeurer chez soi comporte aussi des périls. M. Adesina prévient que si un grand nombre d’Africains sont au chômage dans des pays improductifs, les terroristes n’auront aucun mal à les recruter, comme cela s’est produit au Mozambique.
Face aux nombreux défis auxquels le continent est confronté, ne désespère-t-il pas parfois ?
« Je ne désespère pas. Je me concentre sur les défis que nous devons relever. Prenons par exemple le processus de croissance dont nous parlons beaucoup. Oui, je suis satisfait du chiffre de croissance que nous avons : ce n’est pas le niveau que nous souhaitions, mais nous avons toujours dix des vingt économies à la croissance la plus rapide au monde. »
La route est longue jusqu’au sommet
La familiarité de M. Adesina avec les choix impossibles auxquels sont confrontés les pauvres est inscrite dans son ADN.
Il est le fils d’un ancien ouvrier agricole d’Ibadan, à 128 kilomètres au nord-est de Lagos, pour qui le travail de la terre est inscrit dans les gènes. Sa vie est une remarquable histoire africaine d’ambition, d’inspiration, de détermination et d’application. M. Adesina a grandi en dormant sur une natte, aux côtés de ses frères, sans eau courante ni toilettes modernes.
« J’ai grandi dans la pauvreté. Mon grand-père et mon père travaillaient dans les fermes d’autres personnes pour un penny par jour », m’a raconté M. Adesina à Johannesburg, en 2019.
Un maître mot a guidé la vie de M. Adesina père : l’éducation. Chaque soir, il sortait un tableau noir de la petite maison familiale et enseignait l’anglais et l’arithmétique à ses jeunes fils.
« Un jour, il nous a dit que la différence entre sa vie et celle du secrétaire permanent au travail était comparable à la différence entre la lumière et l’obscurité. Mais il nous a dit que si nous travaillions pour acquérir une éducation, nous et les enfants du secrétaire permanent serions au même niveau », raconte M. Adesina.
Son père a économisé presque chaque centime gagné pour scolariser ses fils. Pourtant, il ne les a pas envoyés dans une école privée. Au lieu de cela, ils sont allés dans une école de village qui comptait 60 élèves par classe.
« Il voulait que nous comprenions la pauvreté rurale. Cela m’a permis de me faire une idée de ce que je voulais faire de ma vie. Cela m’a appris que la pauvreté est une réalité, dont je suis moi-même sorti », explique M. Adesina.
L’école du village a également enseigné au jeune Adesina le pouvoir de l’agriculture sur la vie des pauvres. Il a constaté que lorsque les récoltes étaient bonnes, il y avait toujours de l’argent pour permettre aux enfants d’aller à l’école ; si les récoltes étaient mauvaises, les enfants étaient retirés de l’école pour travailler.
Il a réussi brillamment à l’école et passé suffisamment d’examens pour entrer à l’université à l’âge de 14 ans — un succès qui a provoqué quelques tensions avec son père, qui rêvait d’une carrière médicale pour Akinwumi.
« Mon père a piqué une crise parce qu’il pensait que l’agriculture était l’endroit d’où il venait. Il n’était pas content. Finalement, mon père m’a dit : « Akin, Dieu doit vraiment vouloir que tu travailles dans l’agriculture », se souvient M. Adesina.
Il a obtenu une licence en économie agricole à l’université d’Ife, au Nigéria, en 1981. Il a ensuite obtenu un doctorat dans le même domaine, en 1988, à l’université de Purdue, dans l’Indiana, l’une des meilleures écoles d’agriculture des États-Unis.
Il a mis à profit son expertise agricole dans ses fonctions d’économiste principal à l’Association pour le développement de la riziculture en Afrique de l’Ouest, de scientifique principal à la Fondation Rockefeller et, surtout, de ministre de l’Agriculture du Nigéria de 2010 à 2015. C’est sa réussite dans ce rôle — et les contacts qu’il a noués — qui lui ont permis de se lancer dans la course à la présidence de la Banque africaine de développement.
Une machine à prêter
Quelle a donc été l’importance de ses deux mandats à la tête de la première institution multilatérale d’Afrique, et dans quelle mesure a-t-il progressé dans la résolution des défis les plus pressants du continent ?
Tout d’abord, indique M. Adesina, au cours de ses huit années à la tête de l’institution, il a permis d’accroître le pool de capitaux dont dispose la Banque africaine de développement pour investir sur le continent.
Quand il a pris ses fonctions, il a d’abord augmenté le capital à 201 milliards de dollars en 2019 : il s’élève aujourd’hui à 318 milliards de dollars, précise-t-il.
Il évoque des projets pour lesquels une partie de ces milliards a déjà été déployée. Ainsi, 50 milliards de dollars ont été investis dans les infrastructures au cours des huit dernières années, et des milliards supplémentaires ont été consacrés à l’agriculture.
Il énumère ce qu’il considère comme les principales réalisations de la Banque. « L’Éthiopie est autosuffisante en blé en moins de quatre ans. Nous mettons en place des zones de transformation agro-industrielle et des infrastructures qui permettront l’émergence de chaînes de valeur, pour un montant de 1,7 milliard de dollars », explique-t-il.
» Le Bénin avait l’habitude d’exporter de la fibre de coton. Depuis que nous avons créé des zones de transformation agro-industrielle il y a deux ans, 100 % de leurs fibres sont transformées en textiles d’habillement. Tout leur argent allait au Viêt Nam ! »
Il s’est récemment entretenu avec un groupe d’investisseurs qui souhaitaient exporter de la bauxite depuis l’Afrique.
« Je leur ai dit : Pourquoi ne pas vous lancer dans l’aluminium au lieu de vous limiter à la bauxite ? Sinon, les bénéfices seront réalisés dans un autre pays et vous finirez pauvres ».
Pourtant, M. Adesina admet que les investissements en capital n’atteignent pas les populations défavorisées qui vivent dans les zones rurales. Macrotrends estime que plus de 698 millions de personnes dans la seule Afrique subsaharienne vivent dans des zones rurales, soit environ 57 % de la population — plus de trois fois la population du Nigéria.
« Une grande partie des capitaux investis en Afrique dans les infrastructures vont dans les zones urbaines, alors que la majeure partie de la population vit dans les zones rurales. Si l’on veut vraiment sortir un grand nombre de personnes (de la pauvreté), il faut transformer ces économies rurales, car, à vrai dire, elles ne sont rien d’autre que des zones de misère économique.
La prime de risque injuste de l’Afrique
Même si son mandat touche à sa fin, M. Adesina continue de veiller à ce que les préoccupations de l’Afrique figurent en bonne place dans l’agenda mondial.
Ces derniers mois, il a répété à maintes reprises que le coût du capital était trop élevé en Afrique — en raison d’une « prime de risque » obsolète appliquée au continent par les investisseurs extérieurs et les agences de notation de crédit. L’Afrique est en particulier limitée par une pénurie de capitaux à long terme, moins chers, dits « concessionnels », affirme-t-il.
« Le financement concessionnel a chuté en Afrique. En 2010, l’exposition à la dette des pays africains était d’environ 52 % de financement concessionnel ; aujourd’hui, elle n’est plus que de 25 %. En raison de cette baisse, de nombreux pays se tournent vers les marchés des capitaux, des prêteurs privés et des prêteurs commerciaux… Lorsque vous avez beaucoup de créanciers commerciaux, c’est différent, vous devez agir de manière plus intelligente », explique-t-il.
« Ce que je demande, c’est de la transparence, c’est de la responsabilité… nous voulons que les économies se développent de manière durable sans accumuler des dettes insensées », déclare M. Adesina.
Ce qui désole M. Adesina, c’est que lorsque les pays africains se tournent vers les prêteurs commerciaux, ils risquent de payer le prix fort. Les paiements au titre du service de la dette de l’Afrique s’élèveront à 74 milliards de dollars cette année, contre 17 milliards de dollars en 2010, selon la Banque africaine de développement.
« Le coût de la mobilisation des capitaux en Afrique est trois ou quatre fois plus élevé que dans d’autres régions. Pourquoi ? En raison de la soi-disant « prime de l’Afrique ». Un pays d’Amérique latine — un pays BB en termes de notation de crédit — lève des fonds en même temps qu’un pays d’Afrique. Ce dernier paie 1,1 point de pourcentage de plus en intérêts… C’est une question de perception, et la perception n’est pas la réalité — ce sont les données qui comptent », explique-t-il.
» Quelque chose se passe dans une partie de l’Afrique et on dit que toute l’Afrique est un problème. Un coup d’État s’est produit au Niger et le président kenyan [William] Ruto m’a dit qu’il avait dû payer 220 points de base de plus pour son émission obligataire à cause du Niger, alors que le Niger est éloigné du Kenya !
M. Adesina souhaite que l’un des héritages de son mandat soit la création d’une agence de notation africaine, dirigée depuis le continent et non plus depuis Washington ou Londres. Les pays actionnaires de la Banque africaine de développement ont mandaté la banque pour examiner les moyens d’y parvenir.
« Il ne s’agit pas de rivaliser avec les agences de notation… mais de pouvoir évaluer correctement les risques, de pouvoir comparer les méthodologies et de pouvoir donner une évaluation juste. Certains pensent qu’il s’agit d’une question politique. Ce n’est absolument pas le cas. C’est absurde », déclare-t-il.
« Il s’agit simplement de s’assurer que les risques de l’Afrique sont bien compris et mieux évalués.
Les technocrates de M. Adesina auront fort à faire pour proposer un plan réalisable pour y parvenir dans sa dernière année. S’il y parvient, cela pourrait être l’un des principaux jalons de son mandat à la tête de la Banque africaine de développement.
Parallèlement, M. Adesina souhaite également lever des fonds sur les marchés de capitaux africains.
« Ce ne sont pas seulement les financements libellés en devises étrangères qui importent ; nous devons également recourir aux marchés de capitaux nationaux et utiliser beaucoup plus de financements en monnaie locale, ce que nous faisons. Nous émettons des obligations en monnaie locale, en shillings tanzaniens, en shillings ougandais, en nairas nigérians, en cédis ghanéens, etc.
M. Adesina estime que les gouvernements ont encore un rôle essentiel à jouer pour soutenir le travail de la Banque.
» Le fait de formuler la question en disant que le gouvernement devrait se retirer et laisser le secteur privé agir n’est pas judicieux. Le gouvernement ne peut pas abdiquer sa responsabilité. Dans tous les pays développés, qu’il s’agisse d’énergie, d’aviation, de médicaments, d’infrastructures ou de sécurité, le gouvernement joue un rôle prépondérant », réplique-t-il.
« Le gouvernement doit mettre en place les bonnes politiques, le bon environnement d’investissement, et il doit également injecter de l’argent pour créer des biens publics. Le secteur privé ne va pas créer de biens publics, ne nous y trompons pas. »
La fin d’une ère
Alors que le mandat de M. Adesina en tant que président de la Banque africaine de développement touche à sa fin, la course à sa succession a déjà commencé. Les observateurs estiment que le nouveau président doit être fort, décisif et visionnaire.
La personne qui remportera l’élection de l’année prochaine devra faire face à une énorme pile de dossiers. Alors que de nombreux pays africains sont toujours aux prises avec une dette croissante, une dépréciation de leur monnaie, une inflation élevée et une croissance mondiale atone, la contribution de la Banque africaine de développement au développement économique durable est d’autant plus importante.
Le président actuel a exercé un lobbying intense pour que les droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international (FMI) soient canalisés vers la Banque africaine de développement afin d’accroître la puissance de feu du continent et d’accélérer le développement.
Il incombera au nouveau président en exercice de poursuivre dans cette lancée, de faire valoir l’argument du financement concessionnel et d’acheminer les fonds là où ils sont le plus nécessaires. M. Adesina a posé les jalons, mais il est temps que d’autres prennent le relais.
Alors qu’il est à la recherche de son prochain défi, je demande à M. Adesina s’il a des regrets.
« Non. Je dis toujours que lorsque Dieu a créé les gens, il leur a donné deux yeux devant parce qu’il souhaitait qu’ils regardent vers l’avant. S’il avait voulu qu’ils regardent en arrière, il aurait mis deux yeux derrière la tête. »
Chris Bishop
Chris Bishop est rédacteur en chef et fondateur de Billionaire Tomorrow, rédacteur en chef et fondateur de Forbes Africa et ancien chef de la programmation de CNBC Africa.
 Menu
Menu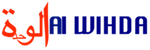
 Afrique : Akinwumi Adesina, le président de la BAD, fait le bilan de ses 8 années
Afrique : Akinwumi Adesina, le président de la BAD, fait le bilan de ses 8 années
















