Une évolution due à un dynamisme économique largement supérieur depuis de nombreuses années, et qui concerne également d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, dont le Bénin et la Guinée qui devraient aussi dépasser le Nigeria en 2024. Selon les dernières données semestrielles fournies par le FMI, en avril dernier, le Sénégal et le Cameroun affichaient respectivement un PIB par habitant de 1 730 et 1 710 dollars en 2023, contre 1 690 pour le Nigeria.
Ainsi, ces deux pays rejoignent la Côte d’Ivoire et la Mauritanie qui avaient dépassé le Nigeria en 2020 et en 2021, respectivement, et dont le PIB par habitant s’élevait à 2 570 et 2 380 dollars en 2023.
Une performance due à un dynamisme économique plus important
Cette évolution constitue une performance assez impressionnante, compte tenu des maigres richesses naturelles non renouvelables du Sénégal et du Cameroun en comparaison avec celles du Nigeria, premier producteur africain de pétrole et troisième pour le gaz naturel.
En effet, et à titre d’exemple, le Cameroun a extrait en moyenne 20 fois moins de pétrole au cours de la décennie 2014-2023 (et près de 23 fois moins en 2023, avec une production d’environ 54 000 barils par jour, seulement, contre un peu plus de 1,2 million), tandis que le Sénégal avait une production encore inexistante en la matière.
Ce dernier a ainsi réussi l’exploit de dépasser le Nigeria avant même de commencer à produire la moindre goutte ou le moindre mètre cube d’hydrocarbures, dont l’extraction vient tout juste de commencer. Une grande performance qui résulte donc d’un dynamisme économique supérieur, et qui s’est naturellement traduit par une croissance économique bien plus forte au cours des dernières années.
En effet, et sur la période décennale 2014-2023, la croissance économique annuelle a été de 5,3 % en moyenne pour le Sénégal et de 3,9 % pour le Cameroun, alors qu’elle n’a été que de 2,0 % au Nigeria. Ainsi, le Sénégal et le Cameroun ont rejoint la Côte d’Ivoire et la Mauritanie qui avaient assez récemment dépassé le Nigeria, grâce à des taux de croissance annuels de 6,5 % et 3,2 %, respectivement, sur les dix dernières années, et avec une accélération récente pour la Mauritanie.
Si cela n’a pas été une grande surprise pour la Mauritanie, grand pays minier tout en étant très faiblement peuplé, cela fut en revanche un véritable exploit pour la Côte d’Ivoire, compte tenu du fait qu’elle a produit, selon les années, de 40 à 60 fois moins de pétrole que le Nigeria au cours de la même période… tout comme elle a extrait six fois moins de pétrole et trois à quatre fois moins d’or que le Ghana voisin, qu’elle a également dépassé pour devenir le pays le plus riche de toute l’Afrique de l’Ouest continentale.
Par ailleurs, et selon les projections du FMI, la richesse par habitant du Nigeria devrait une nouvelle fois baisser en 2024, et le pays devrait donc également être devancé, dès cette année, par le Bénin et la Guinée qui ont enregistré une croissance annuelle de 5,5 % et 5,7 %, respectivement, sur la décennie 2014-2023, et dont le PIB par habitant a atteint 1 410 et 1 530 dollars, respectivement, au terme de la décennie.
Ces différents éléments sont d’ailleurs l’occasion de rappeler que l’Afrique francophone est globalement la partie économiquement la plus dynamique du continent, ainsi que la partie la plus industrialisée, la moins touchée par l’inflation, la moins endettée, ou encore historiquement la moins concernée par corruption, par la violence, les guerres et les conflits ethniques.
À titre d’exemple, l’Afrique subsaharienne francophone, vaste ensemble de 22 pays, a réalisé en 2023 le niveau de croissance économique le plus élevé d’Afrique subsaharienne pour la dixième année consécutive et la onzième fois en douze ans selon les dernières données du FMI (qui confirme la tendance pour cette année 2024), et a enregistré un taux de croissance annuel de 3,6 % en moyenne sur la période décennale 2014-2023 - et même de 4,0 % hors cas très particulier de la Guinée équatoriale, contre seulement 1,9 % pour le reste de l’Afrique subsaharienne (soit un rythme inférieur même à sa croissance démographique).
Un dynamisme que l’on retrouve également au Maghreb, où l’Algérie par exemple, et bien qu’handicapée par une population près de cinq fois inférieure, devrait réussir l’exploit de dépasser le Nigeria au cours de cette année en termes de PIB nominal (la valeur du PIB nominal dépendant en bonne partie de la démographique, ce qui avantage mécaniquement les pays les plus peuplés dans les classements en la matière, même s’ils sont particulièrement sous-développés).
De même, et concernant l’industrialisation, la Banque africaine de développement a révélé dans son dernier rapport, publié en novembre 2022, que le Sénégal était le pays le plus industrialisé de toute l’Afrique de l’Ouest (classé en septième position sur le continent, devant le Nigeria), que la Côte d’Ivoire avait de son côté dépassé le Ghana (13e et 14e, respectivement), que le Gabon, devenu pays le plus riche d’Afrique continentale, dépassait le Botswana, deuxième pays le plus riche et deuxième producteur mondial de diamants après la Russie (occupant respectivement les 12e et 17e places), que la RDC (16e) ou le Cameroun (14e) se classaient devant l’Éthiopie (25e), l’Angola (34e) et le Rwanda (35e), ou encore qu’il n’y avait qu’un seul pays francophone parmi les six derniers pays du classement (en intégrant le Soudan du Sud et la Somalie, si peu développés qu’il ne sont pas mentionnés).
Par ailleurs, le Maroc se plaçait en deuxième position continentale après l’Afrique du Sud, avec un écart si faible qu’il vient probablement de la dépasser, compte tenu du déclin continu de ce géant minier qui n’a réalisé qu’un taux de croissance annuel de 0,7 % en moyenne sur la décennie de 2014-2023, et qui souffre notamment de très fréquents délestages en matière de fourniture d’électricité, dépassant parfois les dix heures par jour (alors qu’ils sont inexistants au Maroc).
Ainsi, et bien qu’étant historiquement la partie globalement la moins dotée en richesses naturelles non renouvelables du continent, l’Afrique francophone a globalement réussi à rattraper son retard et à devancer désormais le reste du continent, grâce à son dynamisme économique supérieur.
Par conséquent, et au lieu de s’inspirer de la naïveté stratégique, tant économique que géopolitique, des acteurs politiques et économiques des pays francophones du Nord (contrairement aux Anglo-Saxons et autres anglophones qui imposent toujours leur langue, même lorsqu’ils sont en situation défavorable, ou encore aux Chinois qui affichent toujours en grand leur langue, même lorsque personne ne la parle), les francophones du Sud devraient s’atteler, au nom de leurs propres intérêts supérieurs, économiques et géopolitiques, à faire la promotion de leur langue française et à imposer sa présence et le respect de son statut de langue officielle ou co-officielle dans les différentes organisations panafricaines et lors et des différents événements économiques, sportifs ou culturels continentaux (sommets, foires et salons, sites internet, affichages publicitaires dans les stades…).
Et ce, d’autant plus qu’ils appartiennent à l’espace linguistique le plus dynamique démographiquement au monde, dont la population a atteint 569,3 millions d’habitants début 2024 (sans compter les personnes sachant parler français ailleurs dans le monde, à différents degrés). L’espace francophone avait d’ailleurs dépassé le monde hispanophone il y a une douzaine d’années, et dont la population est estimée à 482,4 millions d’habitants début 2024.
Environnement plus favorable aux affaires
Comme pour d'autres pays d'Afrique francophone, le dynamisme du Sénégal et du Cameroun est le fruit d’une meilleure gouvernance, d’une plus grande diversification et d’un environnement plus favorable aux affaires qu’au Nigeria, dont l’économie peu diversifiée demeure très fortement dépendante des hydrocarbures (plus de 90 % des exportations du pays), et qui souffre de niveaux particulièrement élevés de corruption et de détournements de fonds publics, ainsi que de graves problèmes d’inflation et d’insécurité à travers le pays.
Pour ce qui est de l’inflation, et selon les dernières données de la Banque mondiale, le Nigeria a en effet enregistré un taux annuel de 13 % en moyenne sur la décennie de 2013-2022 (et plus de 25 % en 2023), contre seulement 1,8 % au Sénégal et 2,2 % au Cameroun. La situation économique est si grave, que le Nigeria ne parvient plus à honorer ses engagements vis-à-vis des compagnies aériennes étrangères, en les empêchant de rapatrier leurs revenus à cause du niveau critique de ses réserves de change.
Ce géant pétrolier et gazier arrive même très largement en tête des pays du monde en la matière, avec 792 millions de dollars de fonds bloqués début novembre 2023, soit le tiers - 33,6 % - de la totalité des sommes retenues à travers le monde (ce qui conduit à des tensions avec certaines compagnies aériennes, comme Emirates qui avait suspendu provisoirement certains vols en 2022).
Le Nigeria a d’ailleurs été classé à la 145e place mondiale dans le dernier classement établi par l’organisation non gouvernementale Transparency international, concernant l’Indice de perception de la corruption, publié en janvier 2024.
Le pays se place ainsi parmi les pays africains les plus corrompus, arrivant très loin derrière le Sénégal qui se situe à la 70e place mondiale et fait donc partie des pays les plus vertueux du continent, largement devant l’Afrique du Sud (83e), l’Éthiopie (98e), l’Égypte (108e) ou encore le Kenya (126e), mais également loin devant le Brésil (104e), la Thaïlande (108e) ou la Turquie (115e).
Par ailleurs, le Sénégal se classe également à la pointe de l’innovation sur le continent africain, en se positionnant à la 93e place mondiale dans le dernier classement publié par l’Organisation internationale de la propriété intellectuelle (Indice mondial de l’innovation, publié en septembre 2023).
Le pays devance ainsi le Nigeria (109e), ou encore le Kenya (100e), le Rwanda (103e) et l’Éthiopie (125e), et dépasse même non moins de huit pays d’Amérique latine.
Le dynamisme économique et la meilleure gouvernance observés au Sénégal et au Cameroun ont donc naturellement eu des répercussions sur les différents indicateurs sociaux de ces pays, qui affichent par exemple un taux d’accès l’électricité supérieur à celui du Nigeria (respectivement 68,0 % et 65,4 % de la population fin 2021, contre 59,5 % selon les dernières données de la Banque mondiale), une plus grande espérance de vie (67,9 ans et 61,0 ans en 2022, contre 53,7 ans pour le Nigeria, soit la troisième plus basse espérance de vie au monde), ou encore un taux de mortalité infantile bien plus faible (28 et 47 pour 1000 naissances vivantes en 2022, contre 69 pour le Nigeria, soit également le troisième taux le plus élevé au monde).
Par ailleurs, ce dynamisme se manifeste également à travers la vitesse de modernisation de ces deux pays, véritables chantiers à ciel ouvert.
Ainsi, et à titre d’exemple, le Sénégal s’est dernièrement distingué par la mise en service, en décembre 2021, d’un train express régional pouvant atteindre la vitesse de 160 km/h dans l’agglomération dakaroise, et faisant de lui le train le plus rapide de toute l’Afrique subsaharienne, à égalité avec le Gautrain sud-africain (le TGV marocain étant, pour sa part, le plus rapide de l’ensemble du continent, avec une vitesse de 320 km/h). En 2024, le Sénégal et le Cameroun devraient donc creuser l’écart avec le Nigeria grâce à leur dynamisme économique.
Un écart qui sera également accentué par le nouvel effondrement de la valeur du naira, reflétant les difficultés économiques du pays et qui s’est écroulé de 40 % en début d’année, suite à une énième dévaluation de cette monnaie largement évitée par les acteurs économiques nationaux et étrangers. À la date du 21 juin dernier, le naira valait ainsi 2 282 fois moins par rapport au dollar américain que lors de sa création, début 1973.
Enfin, et concernant le Sénégal, qui peut se féliciter d’être parvenu à atteindre ce niveau de développement avant de devenir un producteur de pétrole et de gaz, le pays devra toutefois faire face à d’importants défis dans les années à venir, et en particulier en ce qui concerne la bonne gestion des futures ressources qui proviendront de la production d’hydrocarbures, et la lutte contre la menace terroriste venant des pays voisins du Sahel, et surtout du Mali voisin (qui connaît un effondrement sécuritaire depuis deux ans, avec un décuplement des attaques terroristes et du nombre de victimes civiles, assorti d’une importante censure mise en place par le pouvoir et les forces russes, et d’un accaparement progressif, sans contrôle ni transparence, des richesses minières du pays par la Russie, à l’image de ce qui se passe en Centrafrique…).
Si l’émergence d’une nouvelle source de revenus est une chose théoriquement positive, force est de constater, toutefois, que l’existence d’importantes recettes liées à l’exploitation pétrolière s’accompagne souvent, dans les pays du Sud, par un développement considérable des phénomènes de corruption et de détournements de fonds publics, empêchant les populations locales de bénéficier pleinement de ces richesses.
Par ailleurs, l’importance de ces revenus est souvent de nature à éloigner les pays concernés de l’accomplissement des réformes nécessaires à un développement solide et durable, qui ne peut passer que par la poursuite de la diversification de l’économie.
Les nouveaux Premier ministre, Ousmane Sonko, et président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avaient fait la campagne présidentielle en prétendant notamment que leur pays était particulièrement touché par la corruption et la mauvaise gouvernance, alors que le Sénégal avait fait de grands progrès en la matière à tel point de devenir un des pays les moins corrompus et les mieux gérés du continent, ainsi qu’un des pays africains les plus respectés dans le monde. Seront-ils donc capables de maintenir le cap ? Ou feront-ils au contraire régresser le Sénégal, comme tant d’autres « révolutionnaires », ailleurs en Afrique, au cours des dernières années et décennies…
Ainsi, ces deux pays rejoignent la Côte d’Ivoire et la Mauritanie qui avaient dépassé le Nigeria en 2020 et en 2021, respectivement, et dont le PIB par habitant s’élevait à 2 570 et 2 380 dollars en 2023.
Une performance due à un dynamisme économique plus important
Cette évolution constitue une performance assez impressionnante, compte tenu des maigres richesses naturelles non renouvelables du Sénégal et du Cameroun en comparaison avec celles du Nigeria, premier producteur africain de pétrole et troisième pour le gaz naturel.
En effet, et à titre d’exemple, le Cameroun a extrait en moyenne 20 fois moins de pétrole au cours de la décennie 2014-2023 (et près de 23 fois moins en 2023, avec une production d’environ 54 000 barils par jour, seulement, contre un peu plus de 1,2 million), tandis que le Sénégal avait une production encore inexistante en la matière.
Ce dernier a ainsi réussi l’exploit de dépasser le Nigeria avant même de commencer à produire la moindre goutte ou le moindre mètre cube d’hydrocarbures, dont l’extraction vient tout juste de commencer. Une grande performance qui résulte donc d’un dynamisme économique supérieur, et qui s’est naturellement traduit par une croissance économique bien plus forte au cours des dernières années.
En effet, et sur la période décennale 2014-2023, la croissance économique annuelle a été de 5,3 % en moyenne pour le Sénégal et de 3,9 % pour le Cameroun, alors qu’elle n’a été que de 2,0 % au Nigeria. Ainsi, le Sénégal et le Cameroun ont rejoint la Côte d’Ivoire et la Mauritanie qui avaient assez récemment dépassé le Nigeria, grâce à des taux de croissance annuels de 6,5 % et 3,2 %, respectivement, sur les dix dernières années, et avec une accélération récente pour la Mauritanie.
Si cela n’a pas été une grande surprise pour la Mauritanie, grand pays minier tout en étant très faiblement peuplé, cela fut en revanche un véritable exploit pour la Côte d’Ivoire, compte tenu du fait qu’elle a produit, selon les années, de 40 à 60 fois moins de pétrole que le Nigeria au cours de la même période… tout comme elle a extrait six fois moins de pétrole et trois à quatre fois moins d’or que le Ghana voisin, qu’elle a également dépassé pour devenir le pays le plus riche de toute l’Afrique de l’Ouest continentale.
Par ailleurs, et selon les projections du FMI, la richesse par habitant du Nigeria devrait une nouvelle fois baisser en 2024, et le pays devrait donc également être devancé, dès cette année, par le Bénin et la Guinée qui ont enregistré une croissance annuelle de 5,5 % et 5,7 %, respectivement, sur la décennie 2014-2023, et dont le PIB par habitant a atteint 1 410 et 1 530 dollars, respectivement, au terme de la décennie.
Ces différents éléments sont d’ailleurs l’occasion de rappeler que l’Afrique francophone est globalement la partie économiquement la plus dynamique du continent, ainsi que la partie la plus industrialisée, la moins touchée par l’inflation, la moins endettée, ou encore historiquement la moins concernée par corruption, par la violence, les guerres et les conflits ethniques.
À titre d’exemple, l’Afrique subsaharienne francophone, vaste ensemble de 22 pays, a réalisé en 2023 le niveau de croissance économique le plus élevé d’Afrique subsaharienne pour la dixième année consécutive et la onzième fois en douze ans selon les dernières données du FMI (qui confirme la tendance pour cette année 2024), et a enregistré un taux de croissance annuel de 3,6 % en moyenne sur la période décennale 2014-2023 - et même de 4,0 % hors cas très particulier de la Guinée équatoriale, contre seulement 1,9 % pour le reste de l’Afrique subsaharienne (soit un rythme inférieur même à sa croissance démographique).
Un dynamisme que l’on retrouve également au Maghreb, où l’Algérie par exemple, et bien qu’handicapée par une population près de cinq fois inférieure, devrait réussir l’exploit de dépasser le Nigeria au cours de cette année en termes de PIB nominal (la valeur du PIB nominal dépendant en bonne partie de la démographique, ce qui avantage mécaniquement les pays les plus peuplés dans les classements en la matière, même s’ils sont particulièrement sous-développés).
De même, et concernant l’industrialisation, la Banque africaine de développement a révélé dans son dernier rapport, publié en novembre 2022, que le Sénégal était le pays le plus industrialisé de toute l’Afrique de l’Ouest (classé en septième position sur le continent, devant le Nigeria), que la Côte d’Ivoire avait de son côté dépassé le Ghana (13e et 14e, respectivement), que le Gabon, devenu pays le plus riche d’Afrique continentale, dépassait le Botswana, deuxième pays le plus riche et deuxième producteur mondial de diamants après la Russie (occupant respectivement les 12e et 17e places), que la RDC (16e) ou le Cameroun (14e) se classaient devant l’Éthiopie (25e), l’Angola (34e) et le Rwanda (35e), ou encore qu’il n’y avait qu’un seul pays francophone parmi les six derniers pays du classement (en intégrant le Soudan du Sud et la Somalie, si peu développés qu’il ne sont pas mentionnés).
Par ailleurs, le Maroc se plaçait en deuxième position continentale après l’Afrique du Sud, avec un écart si faible qu’il vient probablement de la dépasser, compte tenu du déclin continu de ce géant minier qui n’a réalisé qu’un taux de croissance annuel de 0,7 % en moyenne sur la décennie de 2014-2023, et qui souffre notamment de très fréquents délestages en matière de fourniture d’électricité, dépassant parfois les dix heures par jour (alors qu’ils sont inexistants au Maroc).
Ainsi, et bien qu’étant historiquement la partie globalement la moins dotée en richesses naturelles non renouvelables du continent, l’Afrique francophone a globalement réussi à rattraper son retard et à devancer désormais le reste du continent, grâce à son dynamisme économique supérieur.
Par conséquent, et au lieu de s’inspirer de la naïveté stratégique, tant économique que géopolitique, des acteurs politiques et économiques des pays francophones du Nord (contrairement aux Anglo-Saxons et autres anglophones qui imposent toujours leur langue, même lorsqu’ils sont en situation défavorable, ou encore aux Chinois qui affichent toujours en grand leur langue, même lorsque personne ne la parle), les francophones du Sud devraient s’atteler, au nom de leurs propres intérêts supérieurs, économiques et géopolitiques, à faire la promotion de leur langue française et à imposer sa présence et le respect de son statut de langue officielle ou co-officielle dans les différentes organisations panafricaines et lors et des différents événements économiques, sportifs ou culturels continentaux (sommets, foires et salons, sites internet, affichages publicitaires dans les stades…).
Et ce, d’autant plus qu’ils appartiennent à l’espace linguistique le plus dynamique démographiquement au monde, dont la population a atteint 569,3 millions d’habitants début 2024 (sans compter les personnes sachant parler français ailleurs dans le monde, à différents degrés). L’espace francophone avait d’ailleurs dépassé le monde hispanophone il y a une douzaine d’années, et dont la population est estimée à 482,4 millions d’habitants début 2024.
Environnement plus favorable aux affaires
Comme pour d'autres pays d'Afrique francophone, le dynamisme du Sénégal et du Cameroun est le fruit d’une meilleure gouvernance, d’une plus grande diversification et d’un environnement plus favorable aux affaires qu’au Nigeria, dont l’économie peu diversifiée demeure très fortement dépendante des hydrocarbures (plus de 90 % des exportations du pays), et qui souffre de niveaux particulièrement élevés de corruption et de détournements de fonds publics, ainsi que de graves problèmes d’inflation et d’insécurité à travers le pays.
Pour ce qui est de l’inflation, et selon les dernières données de la Banque mondiale, le Nigeria a en effet enregistré un taux annuel de 13 % en moyenne sur la décennie de 2013-2022 (et plus de 25 % en 2023), contre seulement 1,8 % au Sénégal et 2,2 % au Cameroun. La situation économique est si grave, que le Nigeria ne parvient plus à honorer ses engagements vis-à-vis des compagnies aériennes étrangères, en les empêchant de rapatrier leurs revenus à cause du niveau critique de ses réserves de change.
Ce géant pétrolier et gazier arrive même très largement en tête des pays du monde en la matière, avec 792 millions de dollars de fonds bloqués début novembre 2023, soit le tiers - 33,6 % - de la totalité des sommes retenues à travers le monde (ce qui conduit à des tensions avec certaines compagnies aériennes, comme Emirates qui avait suspendu provisoirement certains vols en 2022).
Le Nigeria a d’ailleurs été classé à la 145e place mondiale dans le dernier classement établi par l’organisation non gouvernementale Transparency international, concernant l’Indice de perception de la corruption, publié en janvier 2024.
Le pays se place ainsi parmi les pays africains les plus corrompus, arrivant très loin derrière le Sénégal qui se situe à la 70e place mondiale et fait donc partie des pays les plus vertueux du continent, largement devant l’Afrique du Sud (83e), l’Éthiopie (98e), l’Égypte (108e) ou encore le Kenya (126e), mais également loin devant le Brésil (104e), la Thaïlande (108e) ou la Turquie (115e).
Par ailleurs, le Sénégal se classe également à la pointe de l’innovation sur le continent africain, en se positionnant à la 93e place mondiale dans le dernier classement publié par l’Organisation internationale de la propriété intellectuelle (Indice mondial de l’innovation, publié en septembre 2023).
Le pays devance ainsi le Nigeria (109e), ou encore le Kenya (100e), le Rwanda (103e) et l’Éthiopie (125e), et dépasse même non moins de huit pays d’Amérique latine.
Le dynamisme économique et la meilleure gouvernance observés au Sénégal et au Cameroun ont donc naturellement eu des répercussions sur les différents indicateurs sociaux de ces pays, qui affichent par exemple un taux d’accès l’électricité supérieur à celui du Nigeria (respectivement 68,0 % et 65,4 % de la population fin 2021, contre 59,5 % selon les dernières données de la Banque mondiale), une plus grande espérance de vie (67,9 ans et 61,0 ans en 2022, contre 53,7 ans pour le Nigeria, soit la troisième plus basse espérance de vie au monde), ou encore un taux de mortalité infantile bien plus faible (28 et 47 pour 1000 naissances vivantes en 2022, contre 69 pour le Nigeria, soit également le troisième taux le plus élevé au monde).
Par ailleurs, ce dynamisme se manifeste également à travers la vitesse de modernisation de ces deux pays, véritables chantiers à ciel ouvert.
Ainsi, et à titre d’exemple, le Sénégal s’est dernièrement distingué par la mise en service, en décembre 2021, d’un train express régional pouvant atteindre la vitesse de 160 km/h dans l’agglomération dakaroise, et faisant de lui le train le plus rapide de toute l’Afrique subsaharienne, à égalité avec le Gautrain sud-africain (le TGV marocain étant, pour sa part, le plus rapide de l’ensemble du continent, avec une vitesse de 320 km/h). En 2024, le Sénégal et le Cameroun devraient donc creuser l’écart avec le Nigeria grâce à leur dynamisme économique.
Un écart qui sera également accentué par le nouvel effondrement de la valeur du naira, reflétant les difficultés économiques du pays et qui s’est écroulé de 40 % en début d’année, suite à une énième dévaluation de cette monnaie largement évitée par les acteurs économiques nationaux et étrangers. À la date du 21 juin dernier, le naira valait ainsi 2 282 fois moins par rapport au dollar américain que lors de sa création, début 1973.
Enfin, et concernant le Sénégal, qui peut se féliciter d’être parvenu à atteindre ce niveau de développement avant de devenir un producteur de pétrole et de gaz, le pays devra toutefois faire face à d’importants défis dans les années à venir, et en particulier en ce qui concerne la bonne gestion des futures ressources qui proviendront de la production d’hydrocarbures, et la lutte contre la menace terroriste venant des pays voisins du Sahel, et surtout du Mali voisin (qui connaît un effondrement sécuritaire depuis deux ans, avec un décuplement des attaques terroristes et du nombre de victimes civiles, assorti d’une importante censure mise en place par le pouvoir et les forces russes, et d’un accaparement progressif, sans contrôle ni transparence, des richesses minières du pays par la Russie, à l’image de ce qui se passe en Centrafrique…).
Si l’émergence d’une nouvelle source de revenus est une chose théoriquement positive, force est de constater, toutefois, que l’existence d’importantes recettes liées à l’exploitation pétrolière s’accompagne souvent, dans les pays du Sud, par un développement considérable des phénomènes de corruption et de détournements de fonds publics, empêchant les populations locales de bénéficier pleinement de ces richesses.
Par ailleurs, l’importance de ces revenus est souvent de nature à éloigner les pays concernés de l’accomplissement des réformes nécessaires à un développement solide et durable, qui ne peut passer que par la poursuite de la diversification de l’économie.
Les nouveaux Premier ministre, Ousmane Sonko, et président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avaient fait la campagne présidentielle en prétendant notamment que leur pays était particulièrement touché par la corruption et la mauvaise gouvernance, alors que le Sénégal avait fait de grands progrès en la matière à tel point de devenir un des pays les moins corrompus et les mieux gérés du continent, ainsi qu’un des pays africains les plus respectés dans le monde. Seront-ils donc capables de maintenir le cap ? Ou feront-ils au contraire régresser le Sénégal, comme tant d’autres « révolutionnaires », ailleurs en Afrique, au cours des dernières années et décennies…
 Menu
Menu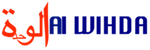
 Richesse par habitant/2023 : le Sénégal et le Cameroun ont dépassé le Nigeria pétrolier
Richesse par habitant/2023 : le Sénégal et le Cameroun ont dépassé le Nigeria pétrolier

















